Le motif des mascarons, l'exemple des mascarons de Bordeaux
|
par
Catherine AUGUSTE,
Ancienne Elève des Beaux-Arts de Paris
designe et décore des cabinets de curiosités
La plupart des photos sont de Marie-Hélène Cingal
voir son
album dédié à Bordeaux sur flickr.com |

© Marie-Hélène Cingal
mascaron à visage d’homme, place Gambetta, Bordeaux, XVIIIe siècle |
Définition et origine
|
|
Mascaron trouve son origine dans l’italien
mascherone « grand masque grotesque » dérivé de
maschera (masque) qui proviendrait lui-même de l’arabe
mascara autrement dit « bouffonnerie ».
Les dictionnaires d’académie désigne le mascaron comme un
ornement d’architecture formé d’une tête ou d’un masque de
fantaisie en ronde-bosse ou en bas-relief pouvant décorer
les clefs d’arcs, les chapiteaux, les entablements, les
fontaines, etc.
L’Antiquité grecque, puis romaine, utilise la représentation
du visage sous forme de masques grotesques voire effrayants
pour chasser les esprits malins. La mythologie raconte que
Persée offrit la tête de Gorgone à Athéna qui en orna son
bouclier alors investi d’un pouvoir protecteur. C’est ainsi
que les masques figurent sur les cuirasses et les boucliers
des guerriers, les tombeaux, la vaisselle, les temples, etc.
De la fonction protectrice le masque gagne aisément la fonction
décorative dans le théâtre grec antique. Initialement les
manifestations théâtrales sont une cérémonie liée au culte
de Dionysos avec chants, danses et sacrifices rituels. Ces
cérémonies restent immortalisées dans les frises décoratives
de l’art grec où l’on distingue guirlandes de fruits et de
feuillages, masques de Dionysos, satyres et Ménades.
De Grèce ce répertoire décoratif passe à Rome, Dionysos
devenant Bacchus et les Ménades les Bacchantes.

© Marie-Hélène Cingal
Deux exemples de mascarons
(1) mascaron de satyre grimaçant : bouche ouverte et
oreilles pointues, barbe envahissante tel le motif de
l’homme vert ; mascaron dans le goût grotesque typique de la
Renaissance italienne bien qu’il date du XVIIe siècle,
Oratorio dei Bianchi, Palerme (Sicile)
(2) mascaron de satyre grimaçant, le traitement assez plat
du visage fait penser à un masque dans le goût antique,
Mont-de-Marsan, place Gambetta
Il faut attendre les découvertes archéologiques de la
Renaissance italienne (villa Hadrien, thermes de Caracalla,
villa dorée de Néron…) pour que les formes de l’Antiquité -
colonnes, pilastres, statues, frontons, masques décoratifs
- reviennent à la mode.
Ces décors retrouvés enfouis vont prendre le nom de
Grotteschi, grottesques en Français avant de perdre un "t"
pour devenir grotesques. Même si le Moyen Age n’avait pas
totalement oublié les représentations de têtes humaines ou
fantastiques, le XVIe siècle revisite pleinement cet
ornement architectural ; les gravures d’ornemanistes qui
circulent à cette époque en témoignent. |
Le mascaron arrive en France
|
Les premiers artistes qui diffusent en
France le répertoire des grotesques constitué en partie de
masques et mascarons travaillent à Fontainebleau pour
François Ier : Le Primatice, Rosso, et avec eux le graveur
René Boyvin.
L’originalité des mascarons de Fontainebleau réside dans le
parti pris d’un relief soutenu qui augmente leur
expressivité, ici nous sommes loin des bas-reliefs de
l’Italie renaissante. Plus tard Jean Goujon décore les
façades de la cour carrée du Louvre de mascarons. Enfin
l’architecte Jacques Androuet du Cerceau par ses recueils de
gravures participe à leur diffusion.
Au XVIIIe siècle les mascarons sont si répandus qu’on les
rencontre dans toutes les villes de France : Paris,
Versailles, Nancy, Strasbourg, Nantes, Mont-de-Marsan,
Pézenas…
|
Les 3000 mascarons de Bordeaux
|
|
A Bordeaux, les premiers mascarons apparaissent
timidement vers la fin du XVIe siècle : l’architecte Henri Roche les
place aux angles des fenêtres de l’Hôtel Martin (1605) - dans
lequel Marie de Médicis sera accueillie en 1615 pour le mariage
de son fils Louis XIII avec Anne d’Autriche, et de l’Hôtel Laubardemont (1608-1612). Ces figures de faunes à barbe végétale, de
ménades, viennent rompre l’austérité des façades. .

© Marie-Hélène Cingal
mascaron au motif de faune, place Gambetta, Bordeaux, XVIIIe siècle
Puis c’est l’explosion au XVIIIe siècle au point que Michel
Suffran évoque « une ville entière de masques » dans son livre
Mascarons de Bordeaux (Editions Les Dossiers de l’Aquitaine, 2004).
La ville doit sa prospérité essentiellement à son port, un des
premiers du royaume dans le commerce du vin, de sucre colonial et
d'esclaves.

© Marie-Hélène Cingal
mascaron de la porte Dijeaux à Bordeaux, monument construit au
XVIIIe siècle à l’emplacement d’un temple gallo-romain dédié à
Jupiter ; le mascaron qui représente Jupiter est de Claude-Clair
Francin, sculpteur actif à Bordeaux
Pendant se siècle d’or de vastes programmes urbains de places et
de rues sont enclenchés afin d’ouvrir la ville hors de ses remparts
moyenâgeux.
La place de la Bourse (ancienne Place Royale), une des œuvres les
plus représentatives de l’architecture classique se pare de
sculptures mais aussi de mascarons. L’architecte Ange-Jacques
Gabriel fait venir le sculpteur Jacques Verbeckt qui est intervenu à
Versailles ; lui succéderont Van der Woort, Pierre Vernet et
Claude-Clair Francin pour la décoration des façades avec mascarons,
agrafes, chapiteaux, trophées et frontons.

© Marie-Hélène Cingal
mascaron à l’homme souriant sur les quais de la Garonne à Bordeaux,
typique du XVIIIe siècle : motif de perles (fréquent sur le mobilier
et les boiseries du XVIIIe siècle) qui isole le visage des feuilles
d’acanthe stylisées
Ce grand élan décoratif se poursuit sur les façades des hôtels le
long des quais de la Garonne et sur les fontaines de la ville
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Puis les dérives du style rococo
amène à un rejet du tout décoratif partout en France, si bien que
l’utilisation du mascaron sera limitée.
Il faut attendre les années 1860 et les grands travaux de voies
nouvelles, cours d’Alsace et Lorraine ou la rue d’Aviau pour que le
mascaron reprenne du service : le style XVIIIe siècle s’exprime à
nouveau par des agrafes et des mascarons sur les arcs des portes ou
des fenêtres et ce jusqu’aux années 1900.
Certains mascarons sont parfois des pastiches de ceux de l’actuelle
place de la Bourse (exemple : ceux de la Bourse du Travail, place
Lainé). Après les deux guerres mondiales ce goût décoratif
s'éteindra, faisant disparaître le mascaron des nouveaux édifices.
Aujourd’hui 3000 mascarons sont recensés sur des centaines de
façades bordelaises. |
Description du motif "mascaron"
|

© Marie-Hélène Cingal
mascaron à l’emplacement de la clef d’arcs de porte, Hôtel de Nice et du
Commerce, Bordeaux

© Marie-Hélène Cingal
lion rugissant sur fond de coquille ; l’asymétrie des motifs d’acanthe de
part et d’autre du lion est typique du style XVIIIe siècle ; sur les quais à
Bordeaux, XVIIIe siècle
|
Le mascaron nous laisse rarement indifférent : il nous
émerveille, nous fait sourire ou exerce un effet de répugnance
car il représente des visages ou des têtes réelles ou fantastiques.
Et y-a-t-il rien de plus efficace pour exprimer une attitude ou un
sentiment qu’un visage ? Au-delà de ce premier contact avec le
mascaron voyons comment il se décline.
Ses emplacements
- sur support vertical : chapiteaux, colonnes, pilastre,
- dans des encadrements de médaillons ou de cartouches,
- sur l’allège (partie du mur entre le plancher et l’appui de
fenêtre) ou clefs des arcs des portes ou des fenêtres,
- accompagne les frises, les frontons ou linteaux - dans
l’architecture religieuse : sarcophages, fonds baptismaux,
- sur les fontaines où il prend la fonction de cracher l’eau. Ses
aspects
- anthropomorphes : nombreuses têtes d’hommes, de femmes et
d’enfants traitées de façon réaliste mais aussi des têtes ailées, des
têtes végétales, motif de l’homme vert.
- zoomorphes : les gueules de lions et de
béliers occupent la première place et sont accompagnées de têtes de chiens, de
cerfs, de dauphins etc.
- fantastiques : têtes de carnaval, têtes de satyres, têtes
d’hybrides et autres monstres. Ses motifs d’accompagnement
Ils sont multiples et varient selon deux critères :
- l’époque et son style : on peut citer le motif de la coquille
au XVIIIe siècle,
- les accessoires nécessaires à la représentation :
par exemple Bacchus et le raisin. Pour décliner quelques motifs :
coquille et coquillage, divers végétaux (fruits, feuilles,
guirlandes…), draperie, chapeaux et turbans, boucles d’oreilles,
collier, couronne, emblème et armoiries (à Bordeaux les trois lunes
encerclent un visage), instruments (compas de la franc-maçonnerie),
attributs (attributs des dieux antiques mais aussi livres), motifs
de cuirs, motifs de ferronnerie, armement…
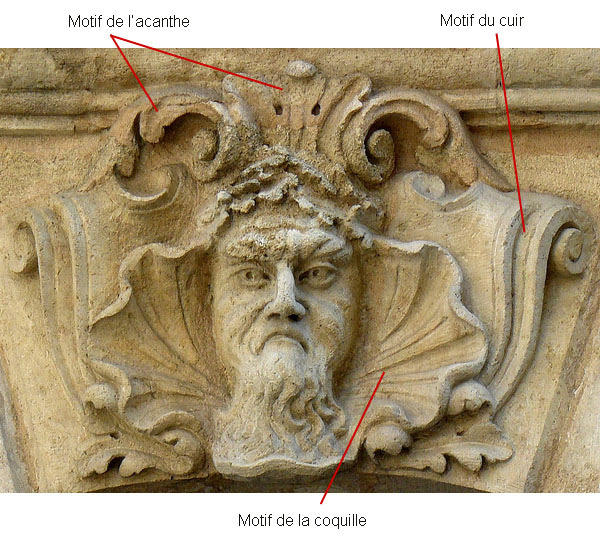
© Marie-Hélène Cingal
les motifs d’accompagnement du mascaron, quai Richelieu, Bordeaux,
XVIIIe siècle Sa facture
Vigoureuse, nerveuse, empâtée, en ronde-bosse plus ou moins
accentuée, réaliste ou stylisée. |
Et le mascaron de Bordeaux...
|
|
Qu’a-t-il
de particulier ? Reprenons pour cela l’angle d’étude proposée
ci-dessus.
Un
emplacement : la clef des arcs
C’est
manifestement sa place privilégiée à Bordeaux, soit en clef de
fenêtres soit en clef de portes.
La
représentation anthropomorphique domine
Les
visages d’hommes et de femmes dominent ; les représentations et les
attitudes sont d’une grande variété à Bordeaux. Pour exprimer ces
attitudes le sculpteur dispose :
- du regard : yeux clos, semi-ouverts ou ouverts, regard de côté,
droit ou vers le spectateur, regard rieur ou perçant,
- du mouvement : le visage tourné ou face au spectateur,
- de la forme de la bouche, puissant moyen expressif : ouverte, close, grave, dents
découvertes, sourire, grimace ou colère.
- de l'attitude indiquée par la chevelure ou la coiffe.
A cette palette expressive de figures féminines gracieuses ou de
portraits de notables s’ajoute l’histoire de la ville de Bordeaux,
premier port de France au XVIIIe siècle :
- goût de l’exotisme avec de nombreuses têtes de Turcs
reconnaissables à leur turban et pierreries (visage turc quai
Richelieu), des visages de marins (rue du Mirail)

© M. Godefroy
le marin et son bandeau, arrière-plan en motif d’écaille de poisson,
rue du Mirail à Bordeaux, début du XVIIIe siècle
- visages africains qui nous rappellent que le
commerce triangulaire fit la richesse de la ville (mascaron de
visage africain avec boucles d’oreilles rue d’Aviau, tête de femme
noire sur la place de la Bourse).

© M. Godefroy
tête de femme africaine, place de la Bourse ancienne place Royale à
Bordeaux, XVIIIe siècle
Une promenade dans Bordeaux nous amène à découvrir nombre de
visages plus ou moins joufflus, graves ou souriants mais aussi :
- le traditionnel corpus mythologique avec Neptune, Bacchus ou
Pomone ,
- et le répertoire fantastique des faunes et grotesques. En cela les
mascarons de Bordeaux reprennent l’héritage antique.
Les motifs d’accompagnement
Les motifs d’accompagnement sont un moyen de personnaliser ou
d’identifier le mascaron. Nous reconnaissons Bacchus par le raisin,
Pomone par les fruits, Neptune par sa longue barbe telle l’écume…
D’autres motifs permettent d’illustrer les particularités d’une
société ou d’une ville comme Bordeaux. En tout premier lieu les
petites armoiries de la ville de Bordeaux. Il s’agit de trois
croissants de lune entrelacés, emblème du port de la Lune dès le
milieu du XVIIe siècle. Sur le quai Richelieu on peut découvrir un
mascaron du XVIIIe siècle au visage féminin surmontée d’une couronne
murale (figuration sans doute des remparts de Bordeaux) et encadrée
des trois croissants de lune.

© M. Godefroy
les petites armoiries de Bordeaux en mascaron, quai Richelieu,
XVIIIe siècle
Les attributs-symboles d’appartenance à un groupe ou à une
obédience
- les symboles de la franc-maçonnerie ; on estime que
Bordeaux regroupait 2000 maçons à la fin du XVIIIe siècle. La
fondation de la Loge Ecossaise à Bordeaux en 1745 par un négociant
entre les Antilles et Bordeaux révèle l’implantation importante de
la franc-maçonnerie bordelaise. Au 22 rue Philippart on découvre le
compas maçonnique sur le torse d’une figure masculine. D’autres
exemples : 15 cours Georges Clémenceau, 9 rue de Mexico, avec compas
et équerre, etc.
- l’appartenance chrétienne est particulièrement illustrée
par l’ancien Hôtel de Nice et du Commerce sur la place du Chapelet.
Les mascarons de la façade présentent les vertus chrétiennes : la
justice avec la balance, la prudence avec le miroir et le serpent et
enfin la foi avec la croix et le calice. Le mascaron du 158 rue
Sainte Catherine figure Jésus-Christ et sa couronne d’épines.
- la présence de la communauté juive à Bordeaux s’est
accrue suite au décret d’Alhambra à la fin du XVe siècle, décret qui
visait à expulser les juifs d’Espagne. Cette communauté florissante
construira des hôtels particuliers. En particulier on découvre des
mascarons à visage d’enfant accompagné d’étoile de David au 54 rue
du Mirail ou encore à l’hôtel de Gasq de la rue du serpolet.

© Marie-Hélène Cingal
représentation de la foi avec la croix et le calice, Hôtel de Nice
et du Commerce à Bordeaux
En guise de conclusion
Le mascaron de Bordeaux doit sans doute son succès à la rigueur
géométrique des façades du XVIIIe siècle, plein âge d’or de la
ville. Trouvant sa place dans cet espace restreint des clefs d’arcs
il offre au regard une légère touche de fantaisie sans rompre la
lecture de l’ordre classique. A cela s’ajoute la montée d’une
société bordelaise riche de l'activité du port et du commerce, une société
qui voit dans l’hôtel particulier l’expression de sa puissance.
Ainsi anges joufflus, têtes grimaçantes, portraits de notables,
divinités grecques, faunes… s’inscrivent un peu comme une signature
des lieux. |
Les livres
|
|
Les mascarons de Bordeaux : Et la pierre s'est faite chair...
de Michel Suffran, Editions Les Dossiers d'Aquitaine, 2004, 158
pages
Depuis bien longtemps (à peu près un quart de millénaire !) dans
notre bonne et belle cité de Bordeaux, une foule silencieuse se
tient là, jour après jour, suspendue au-dessus de nos têtes. Sur les
façades des immeubles comme sur celles des échoppes, les mascarons
font partie du décor urbain. Il ne s'agit nullement de "masques"
mais, bel et bien, de visages, de portraits d'après nature. Tous,
sans exception, portent, inscrits dans leurs prunelles le modelé de
leur chair devenue pierre. Voici venu le temps de considérer ces
prétendus étrangers pour ce qu'ils sont, en vérité : nos fidèles
reflets. Michel Suffran l'écrivain, et François Philip le
photographe, ont uni leur talent et leur passion pour vous offrir ce
Beau Livre à la gloire de nos frères de pierre : les mascarons de
Bordeaux.
Mascarons de Bordeaux : Les veilleurs de pierres
de Richard Zéboulon, Editions Cairn, 2008
Des hôtels particuliers aux constructions modestes, plus de 3000
visages de pierre au répertoire inépuisable (fauves grimaçants,
animaux fantastiques, anges joufflus, visages grimaciers ou narquois
rivalisent avec Neptune ou Bacchus) ornent des centaines de façades.
Croisez votre regard avec ceux, plein de vie de ces visages
immobiles et entrez dans le monde des mythes, dans les
représentations imaginaires et illusoires du théâtre et de la fête.
Au-delà du simple ornement, les mascarons n'invitent-ils pas, pour
peu que l'on tende l'oreille, à écouter les histoires qu'ils vous
content, qui sont autant d'histoires de Bordeaux ? Puisse l'un
d'eux, ne pas vous laisser indifférent et vous donne l'envie de
poursuivre plus loin l'aventure... des cieux de l'Olympe aux rivages
de l'Afrique.
Mascarons: Bordeaux du XVIe au XVIIIe siècle
de Jean Damestoy, Editions Mollat, 1997, 103 pages
Bordeaux, chef d’œuvre classique
de Jacques Sargos, Editions L’Horizon Chimérique, 2009, 407 pages
Chef-d'œuvre classique classé au patrimoine mondial de l'Unesco en
2006, la ville de Bordeaux représente l'un des plus beaux ensembles
européens de grande architecture classique. La Bourse des Gabriel,
le Grand-Théâtre de Victor Louis comptent parmi les plus célèbres
réalisations du XVIIIe siècle. Mais ces monuments grandioses ne
doivent pas faire oublier les innombrables immeubles, les églises,
les hôtels particuliers qu'on ne se lasse pas d'admirer jusque dans
le moindre détail. Ce ne sont, le long des rues, que façades de
pierre blonde sculptées de masques et d'ornements, ferronneries
superbement ouvragées, portes colossales aux lourds marteaux
d'argent mat, églises dont la pénombre abrite des décors de la
Renaissance ou de chatoyants autels baroques.(…) |
Des liens
|

