Jean I Berain (1637-1711), un style
|
par
Catherine AUGUSTE
ancienne élève des Beaux-Arts de Paris
désigne et décore des cabinets de curiosités |

estampe de Jean Berain
Jean I Berain devint premier décorateur à la
cour de Louis XIV en suivant les pas de Charles Le Brun.
Ornemaniste de talent et l’un des plus féconds de la fin du XVIIe
siècle, il fut un rénovateur des motifs de grotesques et
d’arabesques. Berain estompa l’omniprésence des grandes feuilles
d’acanthe dans la composition au profit d’un réseau plus léger
d’entrelacs, de festons et de singeries.
Grâce à sa maîtrise parfaite de la gravure, son œuvre fut largement
répandue et copiée, d’autant plus que l’époque était
particulièrement favorable à la diffusion du modèle versaillais. Son
empreinte fut immense puisqu’il dessina des décors d’opéras, de
fêtes et de pompes funèbres, des habits, des pièces d’orfèvrerie et
d’arquebusiers, des modèles de lambris et de plafonds, des cartons
pour la tapisserie, etc.
|
1/ Une vie dédiée à l’ornement
|
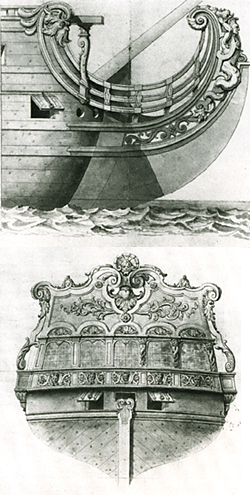
Proue et poupe de vaisseau (Jean
Berain).
On note chez Berain un goût prononcé pour
les lignes courbes, une ornementation liée au
vocabulaire des grotesques : masques,
personnages hybrides, acanthe, fleurons
d’acanthe, coquilles, etc.
|
Jean I Berain naît en 1637 en Lorraine
dans une région ravagée par la Guerre de Trente Ans, son
baptême est attesté le 4 janvier 1640 à Saint-Mihiel dans le
Barrois. Rapidement il quitte la région avec ses parents
pour rejoindre Paris. Son grand-père est arquebusier, son
père également. Ce métier consistait à fabriquer et décorer
des armes à partir de modèles de gravures.
Jean, qui avait le goût du dessin,
apprend les techniques de l’eau forte commune aux graveurs
et aux arquebusiers lorsque ces derniers « imprimaient » le
décor sur les parties métalliques des armes. Sous le nom de
Jean Berain Le Jeune, il publie son premier recueil
d’ornements, Diverses pièces très utiles pour les
Arquebuzières, qui sera édité à plusieurs reprises
jusqu’en 1667. Son deuxième recueil de modèles, cette
fois-ci destiné à la corporation des serruriers, paraît en
1662. Puis Berain, reconnu pour ses qualités de graveur, est
amené à réaliser quelques dessins pour le Cabinet des
planches gravées du roi qui immortalisait tous les grands
événements du règne de Louis XIV.
En 1675 Jean Berain est nommé
dessinateur de la Chambre et du Cabinet du roi, il accède
ainsi au rang des principaux artistes de la cour. Sa mission
est d’exécuter toutes sortes de dessins, de perspectives de
carrousels, de figures et d’habits pour les fêtes et les
comédies, de modèles de costumes à la mode. Il cumule les
fonctions de Dessinateur des jardins en 1677 puis de
décorateur de l’Opéra de Paris auprès de Lully en 1680.
La période fastueuse des fêtes et des
représentations à la cour s’achève à la fin des années 1680,
Berain s’oriente alors à la création de décor pour quelques
commanditaires renommés comme Condé, Conti et le marquis de
Seigneulay (fils de Colbert), son plus grand mécène. Ce
dernier lui délivrera la charge de dessinateur des vaisseaux
de la flotte royale, succédant à Charles Le Brun.
L’apogée de Jean Berain se situe à
cette fin du XVIIe siècle lorsque sa carrière
dépasse les frontières par les sollicitations des cours
étrangères, notamment la cour de Suède, mais surtout par la
diffusion de ses estampes ; ses contemporains, parmi eux
André-Charles Boulle, collectionnaient ses modèles bien
avant son décès ce qui permit le développement
du « style Berain ».
En 1704, fatigué et moins sûr dans son
dessin, il transmet sa charge de dessinateur à son fils Jean
qui déjà le secondait.
En 1711, Jean I Berain meurt en
laissant à ses héritiers un capital important.
|
2/ De l’héritage des grotesques au style Berain
|

Fragment de
lambris en chêne peint et doré (fin XVIIe
siècle). Les gravures de Berain devaient être interprétées
avant tout comme des suggestions pour la décoration
intérieure et les meubles. Ce lambris en offre un bon
exemple. Un décor en rinceaux et en rubans, aéré par des
guirlandes, un motif de vase et un mascaron entourent un
cartouche comportant un monogramme couronné. |
Les premiers ouvrages de Berain, l’héritage des
grotesques
Les premières planches gravées de
Berain pour les arquebusiers en 1659 témoignent du goût
décoratif de son temps : un réseau de rinceaux où
s’organisent et se cachent des êtres fantastiques, des
animaux en course, des oiseaux perchés et des masques
grimaçants. Berain emprunte également quelques petites
figures à la Callot qu’il place dans cet enchevêtrement de
rinceaux. Son dessin est déjà gracieux et ses compositions
plus aérées que ces contemporains.
Dans cette deuxième moitié du XVIIe
siècle, la France apprécie ces constructions bizarres des
grotesques, puisées dans les formes antiques et qui avaient
cette étonnante souplesse d’adaptation à l’ensemble des arts
décoratifs. Charles Le Brun (1619-1690), peintre et
décorateur de Versailles, avait dessiné les décors de
Versailles selon le principe d’un réseau symétrique et
chargé de rinceaux de feuilles d’acanthe lourde où le
végétal prédomine. Son influence sur le premier Berain est
certaine. Mais ce dernier va les réinterpréter à la fin du
XVIIe siècle et leur donner nouveau regain sous
le nom d’arabesques.
Les composantes de ce nouveau style
Jean Berain ne cherche pas l’authenticité, il
ne puise pas dans les sources antiques de l’arabesque mais il
s’appuie sur une interprétation de seconde « main » : les loges de
Raphaël et de façon générale les ornemanistes flamands et italiens
du XVIe siècle.
Il donne aux rinceaux d’acanthe une forme
beaucoup plus ample où les personnages et les animaux peuvent
s’installer. Il emprunte quelques motifs à l’Ecole de Fontainebleau
comme les cariatides, les précieux dais ou les corbeilles de fleurs.
Il ajoute à ce répertoire quelques motifs qui lui sont chers :
singes qui se tournent le dos, souris accrochées à une ficelle,
oiseaux en mouvement, faunes jouant de la musique, etc. La nature ne
se réduit plus à l’acanthe qui est désormais concurrencée par les
roseaux, oliviers et pampres des fêtes dionysiaques.
Berain avait commencé au Cabinet du roi par
dessiner des costumes de fêtes, des perspectives de carrousels, ce
travail consacré au spectacle a sans doute influencé sa
réinterprétation des grotesques en lui apportant des clins d’œil
divertissants. La fête, de façon générale, est le thème favori de
l’arabesque depuis l’Antiquité. A cette fin du XVIIe
siècle il y a un renouveau du goût de la comédie. Il n’est donc
guère étonnant que Berain s’empare de ce répertoire ornemental : ses
singeries et autres animaux aux attitudes changeantes sont propices
au rire.
La composition
Les compositions ne s’appuient plus seulement
sur le triomphe des rinceaux car Berain introduit un jeu de bandes
rectilignes héritières des entrelacs. Cette nouvelle structure de
lignes, symétrique et assez rigoureuse, permet une mise en scène des
dais, drapés et silhouettes sautillantes et burlesques où le fond,
difficile à entrapercevoir sous Le Brun commence à gagner de
l’importance.
Ce jeu de bandes va jusqu’à border les panneaux
pour constituer un cadre autour duquel s’organisent une bordure et
des pilastres verticaux. Ses compositions pour les tapisseries des
Gobelins ont probablement développé cette tendance à la bordure dans
ses arabesques. A l’intérieur du cadre, Berain hiérarchise les
espaces : le dais central indique le sujet principal autour duquel
le décor d’arabesque encore fortement présent s’organise. Cette
construction est une préfiguration de ce que Watteau produira au
XVIIIe siècle : une scène centrale primordiale entourée
d’arabesques secondaires.
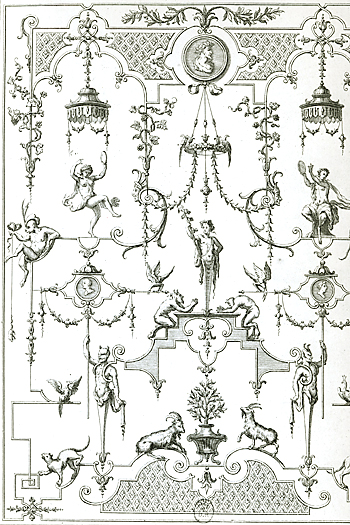
Les grandes feuilles d’acanthe, qui
dans ses premiers projets (1667) jouaient encore un rôle
important, furent plus tard supplantées en grande partie par
d’autres éléments décoratifs, notamment un jeu de bandes.
Cette
estampe mettant en scène des jeux et des singeries reste en
dépit de la petitesse des personnages, d’une grande clarté
dans sa composition. Ici Berain se rapproche de la tradition
des arabesques de la renaissance italienne par sa
composition.
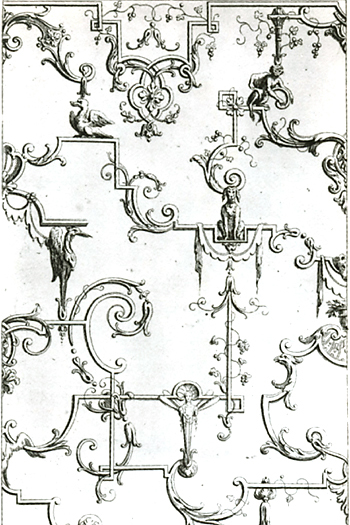
Les estampes de Berain ont été éditées à des dates variables
en France mais plutôt tardivement dans la vie de l’artiste
(la grande majorité de l’œuvre est publiée vers 1690 et
surtout vers 1703-1710). Plus important peut-être encore
pour leur diffusion est le fait qu’elles aient été copiées à
Augsbourg et aux Pays-Bas. |
3/ L’influence de Berain
|

Aiguière en faïence de Moustiers en décor dit à la Berain.
Très typique de la production de Moustiers qui favorisa ce
décor dit abusivement à la Berain, l'arabesque est composée
d'un sujet principal et central, entouré d'ornements annexes
: fleurons, acanthes légères, jeu de bandes, suspension...
Très apprécié dans la céramique, le décor dit à la Berain a
été repris également dans la faïence de Nevers |
Deux origines expliquent le succès et
l’influence de Berain :
- La diffusion de ses estampes,
- La création d’un style nouveau.
La diffusion des estampes
Jean Berain est né dans une famille
d’artisans arquebusiers qui devaient savoir manier
l’eau-forte pour le décor de l’argent, du cuivre ou de
l’acier de l’arme au même titre que les graveurs d’estampes.
Les armes ont toujours constitué des espaces privilégiés
d’invention pour l’ornement grotesque qui s’adapte aux
espaces dissymétriques ou pas.
Jean Berain a donc fleuri dans le foyer privilégié pour
apprendre le dessin, l’ornement et la gravure. Rapidement
ses compétences lui permettent d’éditer son premier recueil
de modèles en 1659.
Il fut par la suite l’un des maîtres
graveurs les plus féconds de ce XVIIe siècle.
L’estampe a toujours été le grand
véhicule du modèle ornemental. Les plus grands centres de
production sont Paris, Nuremberg et Augsbourg.
Des estampes françaises furent publiées en France mais aussi
à Augsbourg qui s’était spécialisée dans la réédition de
gravures françaises avec souvent des titres et des légendes
faux. C’est ainsi que l’on a attribué l’origine de certaines
tapisseries à Berain à tord.
La multiplication des gravures par des rééditions
successives ainsi que leur diffusion élargie à l’Europe ont
contribué certainement à la célébrité de Berain.
La création d’un style
La seule explication du succès de Berain par
l’estampe et sa diffusion ne suffit pas. Il a créé un style original
qui a pu s’épanouir grâce à son milieu d’arquebusiers et au contact
de l’art officiel de Versailles lorsqu’il devint dessinateur du
Cabinet du roi. Le nom de Berain reste attaché au renouvellement du
genre grotesque par l’allégement de ses acanthes trop lourdes et
l’introduction de la fantaisie. Ses compositions d’arabesques
toujours équilibrées préfigurent l’arabesque de Claude Audran encore
plus légère et celle de Watteau rococo.
Berain est un ornemaniste, il crée des modèles
pour d’autres artisans qui leur donneront leur forme. Les
témoignages qu’il nous reste au travers de techniques les plus
variées nous laissent imaginer son influence : les tapisseries des
Gobelins, les faïences de Moustiers au décor à la Berain, les
meubles en marqueterie d’écaille et de cuivre d’André-Charles
Boulle, etc.
Il bénéficia des meilleurs artisans pour
réaliser ses projets pendant ses années au Cabinet du roi mais aussi
chez les grands seigneurs. Ces commanditaires exercèrent une forte
influence pour la diffusion et la pérennité de son œuvre. Et puis,
son fils Jean qui l’avait secondé pendant des années, perpétua
certainement son style jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
On comprend là comment un style peut être
transmis.
|
|

