Le lit : histoire et formes
Un brin d’histoire du lit
|
|
On peut considérer le lit comme le meuble le
plus important de la maison puisque nous y passons le tiers de notre
vie. Nous y dormons, il est le lieu privilégié des amants et son
port d’attache, il nous aide à nous remettre de nos maladies, il est
la scène où prennent place les rêves et quelles que soient ses
fonctions, il est omniprésent de notre naissance à notre décès,
étant souvent le lieu de notre premier souffle de vie et de notre
dernier rite de passage.
Certaines personnalités célèbres ont même
considéré le lit comme lieu de travail : Winston Churchill
travaillait alité pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Matisse,
âgé, dessinait sur les murs qui entouraient son lit avec des
morceaux de fusain fixés à une canne ; Rossini y composa plusieurs
opéras et Colette y a écrit bon nombre de ses romans; le poète John
Milton conçut alité «Le paradis perdu» tandis que ses filles
transcrivaient ses vers; et finalement, Marcel Proust, le plus
célèbre des artistes atteints par la maladie, écrivit «À la
recherche du temps perdu» au lit.
La sédentarisation de l’homme a sans nul doute
poussé ce dernier à rechercher des formes plus complexes que la
simple couche posée au sol pour des raisons aussi diverses que :
s’extraire de l’humidité du sol, se protéger des animaux, se cacher
de la lumière, se reposer à l’abri… D’où cette longue chaîne
d’inventions au service du confort ou de l’apparat qui nous fera
voir les lits les plus extravagants en ornement ou en accessoires
jusqu’aux lits les plus dépouillés d’aujourd’hui où le repos absolu
est recherché dans la technicité du matelas.
Les lits de prince, des meubles d’apparat
Les premiers lits
Les lits qui nous viennent des temps les plus reculés sont les
lits des princes, ceux sur lesquels le plus grand soin a été porté
pour les fabriquer et les conserver. Au XIVe siècle avant
J.-C.,
Toutankhamon emporta cinq lits dans sa tombe pour
l’accompagner dans l’autre vie ! Les lits en bois étaient ornés de
fleurs de lotus et incrustés de matières précieuses (ivoire, or,
argent). Ils comportaient des appuie-tête, en bois ou en ivoire
sculptés, servant à soutenir les volumineuses coiffes des pharaons,
et des tabourets relevant les pieds. Ces lits étaient conçus pour
durer, au sens propre du terme, toute l’éternité.
Plus proche de nous, les bas-reliefs assyriens
du VIe siècle avant J.-C. nous indiquent qu’il y existe
deux manières d’utiliser le lit : l’une pour manger et l’autre pour
dormir. L’ornementation est toujours riche et constituée de pin
ouvert, de marguerites aux pétales partant du cœur, de rinceaux de
plantes, de flèches ou de lames. Accordant la plus grande importance
aux animaux qui symbolisaient la force, les lits des souverains
étaient aussi décorés de taureaux, de béliers, de lions et de grands
serpents, souvent incrustés de pierres précieuses et posés sur de
luxueux tapis entassés pour plus d’aisance. Les nomades de ces
civilisations dormaient sur des peaux de chèvres emplies d’eau pour
s’isoler de la terre froide.
Dans la Grèce antiques, matelas, couvertures,
molletons, tapis et peaux de bêtes étaient amoncelés sur des
lanières de cuir entrelacées. Les draps étaient rares mais les
couvre-lits étaient richement brodés, de même que les oreillers,
placés à la tête et au pied du lit.
Les pieds étaient plus hauts que ceux des lits égyptiens. Cette
caractéristique permettait ainsi aux Grecs de prendre part à de
gigantesques festins dans leur lit, le service étant facilité par
cette nouvelle hauteur.
Dans la civilisation romaine, le lit était la
marque d’une grande richesse. Le rôle des tissus était considérable;
les lits, les sièges n’étaient rembourrés que de coussins volants, à
la mode orientale et il y a une volonté de confort qui se traduit
par une courbe dans le dossier. Le lit de repos était encore très
haut et l’on s’y accoudait pour les repas. Inspiré du lit grec, il
comportait comme éléments nouveaux des pieds tournés, une tête et un
pied de lit. La mode était à l’ostentation.
Les lits du Moyen-Âge et de la Renaissance
Il y a toujours deux types de lit : ceux des riches et des
nobles et ceux des populations plus ordinaires. Pour les premiers,
l’usage du lit, raffiné et extravagant, qui existait dans les
civilisations anciennes, va continuer sous d’autres formes. Pour les
seconds, les lits les plus courants étaient un sac de toile, de la
paille et un endroit où dormir. On cherche le confort de la chaleur
pour passer la nuit. Au Moyen Âge, période de grande vulnérabilité
et d’insécurité, les rois et les seigneurs étaient nomades. Le
mobilier était soit fixe et lourd comme le lit soit facile à
déplacer comme le coffre. Les lits médiévaux à baldaquin avec ses
drapés sont une constante des enluminures. Ils étaient conçus de
manière à ce que l’on puisse dormir en position assise, avec des
coussins pour surélever la tête. Les tentures entourant le lit vont
prendre de plus en plus d’importance et devenir des lieux de
déploiement de richesse mais aussi permettre une plus grande
intimité au couple.
Avec la Renaissance, les chevets de lit vont
devenir des supports de décors sculptés. Du fait de sa valeur, le
lit fait désormais partie du mobilier familial et on le mentionne
souvent dans les testaments. Les femmes utilisèrent rapidement le
lit comme un moyen de signifier leur situation et leur importance
sociale.
Le lit fait partie de l’apparat des cérémonies : on dort dans un lit
plus simple et on reçoit dans celui d’apparat. Les étoffes des dais
et baldaquins drapées et brodées, établies au plafond depuis les
coins des pièces, permettaient d’assurer chaleur et intimité. La
condition sociale du résidant était désignée par la longueur du dais
: les dais de la dimension du lit étaient réservés aux nobles alors
que les dais de dimension moindre étaient destinés à la petite
aristocratie. À l’autre extrémité de l’échelle sociale, les lits
étaient tout à fait différents - le sommeil était une activité
communautaire. Les lits accueillaient plusieurs personnes, ce qui
explique qu’à cette époque ils étaient souvent très grands.
Les lits de parade des rois Louis de France
Le lit prend donc une importance croissante à partir de la
Renaissance et ce jusqu’à la Révolution. La civilisation européenne
était à son apogée, la France, carrefour de la culture occidentale,
pouvait s’enorgueillir de
nombreux lits parmi les plus somptueux. On
va jusqu’à placer aux quatre coins du ciel de lit bouquets de plumes
et vases en passementerie. Tous les rois s’offrirent des lits
extravagants. Louis XIV en possédait plus de quatre cent lits, pour
la plupart ornés de chevets et de garnitures très ouvragés. Il
aimait rester au lit et tenait souvent audience dans sa chambre, où
il délivrait ses ordonnances dans une position de repos.
Du lit de parade au lit confortable
Le règne du lit prit fin après la Révolution.
Il devient alors un élément de mobilier plus intime et fonctionnel.
Pour une classe bourgeoise ou de petite noblesse en plein essor, les
artisans vont proposer de nouvelles variantes de lit car la façon de
se reposer s’apprécie différemment selon les moments de la journée,
de la vie et des lieux : ainsi la pratique des lits jumeaux à la se
multiplie à la fin du XVIIIe siècle pour permettre aux
couples de dormir au frais pendant les mois d’été. De même,
apparaissent les lits en fonte et les matelas de coton, deux
éléments qui contribuent à rendre le lit moins attirant pour les
insectes nuisibles (punaises). La mise en place de modes de
production annonce les productions en série.
Au début du XIXe siècle, c’est
l’époque où l’on voit la première utilisation du ressort et
l’apparition des premiers meubles populaires en fer forgé.
L’heure est désormais à l’industrialisation. On
assiste à la création d’un nombre impressionnant d’ateliers où la
machine-outil (chaudière à vapeur) permet toutes les audaces :
découper le bois, le fendre, le tourner, le blanchir, le polir, le
mortaiser, le percer ; fabriquer des tenons, des queues d’aronde
mécaniques, des tourillons; en un mot, confectionner toutes les
composantes d’un meuble. De nouvelles formes voient le jour : des
lits muraux encastrés, des berçantes mobiles sur plate-forme, des
fauteuils à crémaillère au dossier adaptable, des divans-lits, etc.
Les techniques de rembourrage sont grandement améliorées et
augmentent le confort.
Le lit d’aujourd’hui : le sommeil réparateur
L’invention du ressort métallique pendant la
Révolution industrielle puis celle de la mousse dans les années 40
permirent le développement du matelas à ressorts et du matelas en
mousse de latex et de polyuréthane. Ce confort minimum devint alors
accessible à tous. Et c’est bien ce premier critère qui entre dans
le choix d’un lit aujourd’hui : nous voulons tous un sommeil
réparateur par un dos bien traité.
Le lit d’aujourd’hui est le plus souvent composé d’un matelas à
ressorts et d’un sommier à lattes ou tapissier qui sert à le
soutenir. Ces deux éléments peuvent être posés à même le sol, sur un
cadre métallique, ou encastrés dans un bois de lit. Il y a de
nombreuses formes et dimensions de lits et la normalisation des
tailles de matelas est une notion relativement récente. Le matelas
idéal doit soutenir le dos de façon à ce que la colonne vertébrale
conserve la même position qu’en station debout.
La fabrication des matelas est aujourd’hui très
sophistiquée. Souples, durs, en mousse, en latex, en laine, à
ressorts cylindriques, à ressorts ensachés et à eau (cylindre en
vinyle extrafort remplis d’eau), il y en a pour tous les goûts et
toutes les morphologies. Ils sont classés selon leur largeur, qui va
de 80 à 180 cm. Leur longueur est en principe de 190 à 200 cm; ils
doivent permettre une liberté de mouvement de chaque côté.
Et pour ceux et celles qui ne désirent pas un
matelas traditionnel, les possibilités sont multiples : le futon
composé de couches de coton, le matelas d’eau qui reprend le
principe des nomades perses qui il y a trois milles ans dormaient
sur des peaux de chèvres remplies d’eau, ou le matelas du troisième
millénaire, un matelas de mousse viscoélastique qui réagit à la
température et au poids. Conçue et développée pour le programme
spatial de la NASA en 1970, cette mousse devait mouler la forme du
corps des astronautes tout en allégeant la pression associée au
décollage et au vol. En 1991, la compagnie suédoise Fagerdala World
Foam présente une version améliorée de cette mousse, connue sous le
nom de TEMPUR, destinée à l’usage domestique et médical.
Le confort absolu n’est-il pas devenu le luxe de nos jours au
détriment du décor et de la parade ?
|
Quelques lits particuliers
|
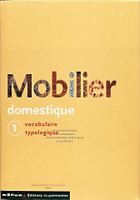
Pour avoir d'autres informations sur le lit et
le mobilier en général :
Le mobilier domestique, tome 1 : vocabulaire typologique
de
Nicole de Reynies |
Vous retrouverez ci-après une liste non
exhaustive des différentes formes de lits et leur représentation.
|
|
Meuble d'apparat
Meuble exécuté dans des bois
précieux avec un soin particulier et figurant dans les
pièces de réception dans le but de donner une impression
de faste et de somptuosité. À l’époque de Louis XIV, les
principaux meubles d’apparat étaient le lit et le
fauteuil.
|
|

baigneuse dite méridienne gondole, 1830
|
Baigneuse
Aussi nommée méridienne en gondole,
la baigneuse désigne un lit ou un divan de repos, de
forme ovale, rappelant celle d’une baignoire, d’où son
nom. Introduite en France sous l’Empire, son dossier se
prolonge de façon à former deux accoudoirs placés à des
hauteurs différentes. |
|
|
Banc-lit
Aussi nommé banc de quêteux, ce
meuble, dont le siège et la façade se rabattaient par
terre, formaient une boîte dans laquelle était étendue
une paillasse qui servait à l’occasion de lit au quêteux
de passage ou aux enfants de la maison.
|
|
|
Berceau
Lit pour jeunes enfants que l’on
peut déplacer pour garder et surveiller l’enfant durant
son sommeil. On dit aussi berceau à barattin,
bercelonnette ou berceaunette. |
|
|
Cabane
Expression canadienne-française, du
début de la colonie, qui désigne un lit entièrement
clos, formant une sorte d’armoire dans laquelle on
installait une couche. Particulièrement utilisée par les
premiers colons venus de France pour se prémunir contre
les rigueurs de l’hiver nordique.
|
|
|
Lit carriole
Terme québécois désignant un lit
qui, par la forme du chevet et du piétement suivant des
influences Empire, rappelle le traîneau d’hiver canadien
(carriole) monté sur patins. C’est le lit-bateau
français.
|
|

chaise longue forme crapaud, 1879
|
Chaise longue
Siège caractérisé par un dossier
incliné et une assise allongée permettant d’étendre les
jambes de manière confortable. Ce type de fauteuil
constitue, avec la bergère, la pièce de mobilier la plus
typique du XVIIIe siècle et des premières années de
l’Empire. Les chaises longues qui sont rembourrées et
souvent constituées de trois éléments (dossier, assise
et repose-pied parfois terminé par un dossier) se
nomment duchesses et étaient utilisées comme lits de
repos ou lits de jour.
|
|

duchesse brisée en deux, le repose-pied est amovible,
1772
|
Duchesse
Nom ancien désignant la chaise
longue. La duchesse, élégante chaise longue capitonnée,
utilisée surtout par les femmes comme lit de repos, est
introduite en France sous le règne de Louis XV. |
|
|
Hamac
Généralement en filet ou en toile,
il se suspend à deux points fixes et sert pour le repos,
la sieste ou pour se bercer agréablement. |
|
|
Lit à baldaquin
Lit du XVIIe siècle, surmonté d’un
baldaquin d’où tombent des tentures. Le baldaquin était
un élément de couverture généralement formé d’un châssis
en bois reposant sur des colonnes et revêtu d’une pièce
de tissu retombant en drapé.
|
|
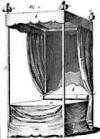
lit à quatre colonnes, 1771
|
Lit à colonnes
Lit à dais comportant quatre
montants verticaux. |
|

lit à la duchesse, 1771
|
Lit à la duchesse
Pièce de mobilier d’apparat
utilisée en France au XVIIIe siècle. Ce type de lit
était richement garni de tissus précieux et présentait
un baldaquin soutenu par un dais appuyé contre le chevet
du lit ou contre le mur, surplombant la couche entière. |
|
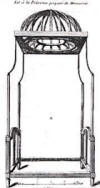
lit à la polonaise avec dais en dôme, 1788
|
Lit à la Polonaise
Avec deux têtes d’égale hauteur
réunies sur un côté et appuyé contre le mur, ce lit est
habituellement réservé aux alcôves. Son baldaquin est
supporté par parties métalliques incurvées. Le dais est
de dimensions inférieures à la surface du lit. Il fut
très à la mode sous le règne de Louis XVI. |
|

lit à trois dossiers à la turque, 1771
|
Lit à la Turque
Lit de repos, à l’aspect d’un divan
massif, à accoudoirs arrondis, caractéristique du
mobilier français de la fin du XVIIe siècle. Surmonté
d’un petit baldaquin en forme de coupole, ce lit était
appuyé au mur, duquel retombaient deux panneaux de tissu
précieux, drapés sur les accotoirs. À la mode sous le
Second Empire. |
|
|
Lit bateau ou en bateau
Il s’agit des formes les plus
répandues durant le XIXe. Il comporte deux montants de
même hauteur, incurvés vers l’extérieur et reliés par
une traverse profilée qui en prolonge la courbure.
Généralement placé contre un mur, ses accotoirs à
rouleaux et le longeron visible présentaient un
mouvement curviligne rappelant la forme d’une
embarcation. |
|
|
Lit clos
Lit fermé par des battants que l’on
trouve encore en Bretagne. Ce type de lit était nommé
«cabane» dans le Canada français.
|
|
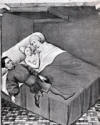
lit d’ange à demi-ciel plat, XVe siècle
|
Lit d'ange ou lit à l'ange
Au Moyen-Age et à la Renaissance on
l’appelait lit à demi-ciel. Il s’agit d’un lit de bout
surmonté d’un dais de même largeur que le lit mais de
longueur inférieure. À la mode sous les règnes de Louis
XV et de Louis XVI. |
|

lit de bout avec un chevet, XVe siècle
|
Lit de bout
Également nommé lit du milieu, il
s’agit d’un lit placé perpendiculairement au mur. |
|
|
Lit de parade
Utilisé après le lit de travail,
suite à l’accouchement, mère et enfant étaient
transportés dans ce type de lit pour recevoir famille,
amis et visiteurs. Il était habituel de baptiser les
nouveau-nés sur des lits de parade décorés ou dans un
lit d’apparat. C’est donc un lit honorifique dans lequel
une personnalité peut être installée pour recevoir ou
être placé à son décès. Souvent il est monté sur une
estrade.
|
|

lit à la romaine, le dais est séparé du bâti, vers 1807
|
Lit impérial
Synonyme de «lit à la Grecque» ou
«lit à la romaine», celui-ci fut très en vogue en France
sous l’Empire et la Restauration. Appuyé au mur du côté
de sa longueur, il est complété par un baldaquin et des
draperies sur son mur d’appui. |
|

pliant métallique en trois parties articulées
|
Lit pliant
Sorte de lit aux parties articulées
pour être plié. |
|
|
Lit de repos
Sorte de banquette ou de fauteuil
capitonné servant à se reposer le jour, qui présente une
forme allongée, supportée par un petit piétement et un
dossier incliné. Apparu au XVIIe siècle, il fut en vogue
au siècle suivant dans les versions duchesse,
duchesse-brisée et méridienne. Les lits de repos ainsi
que les chaises longues, les fauteuils, les divans et
les sofas constituent des lieux à part réservés à la
lecture ou à la rêverie. |
|

lit de travers à trois dossiers, XVIIIe siècle
|
Lit de travers
Lit rangé parallèlement au mur
c’est-à-dire adossé par un long-pan. |
|

méridienne confortable, 1833
|
Méridienne
Lit de repos destiné à la sieste,
caractéristique du mobilier français, de plan
rectangulaire à deux chevets d’inégale hauteur, réunis
par un dossier incliné. Synonyme de «lit à la Grecque»
en raison de ses lignes classiques. Il fut en vogue dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle |
|

lit simple en tombeau, 1771
|
Lit en tombeau
Lit du XVIIe siècle dont la
courtine tombe obliquement du baldaquin se dirigeant
vers le pied. |
|

turquoise, lit de repos à deux chevets enroulés, mi
XVIIIe siècle
|
Turquoise
Variété de la sultane, la turquoise
est un lit de repos ne comportant que deux dossiers
enroulés en crosse. Nommée aussi sultane, elle est du
goût manifeste des turqueries du XVIIIe siècle. |
|
Termes se rapportant au lit
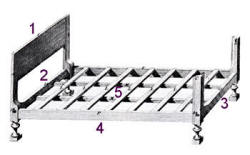
1
Le chevet : terme utilisé pour qualifier la tête de lit, panneau du
châlit plus élevé que le panneau du pied et les battants, faisant
parfois partie du support du baldaquin.
Le dossier : partie droite, inclinée, incurvée, réglable, pleine ou
ajourée, nue ou habillée, d'un siège, d’un fauteuil, d’un divan ou
de tout autre meuble, sur laquelle s'appuie le dos. Ce terme désigne
aussi la planche rembourrée ou en bois qui est placée au chevet du
lit. La forme du dossier et sa décoration marquent l’appartenance
d’un siège à un style.
2
Le court pan : traverse du chevet, ou du dossier de lit, reliant les
pieds.
3
Pied de lit : extrémité du châlit d’un lit.
4
Longeron : pièce longitudinale du bâti d'un meuble, par exemple,
dans un lit. C’est l’élément horizontal qui raccorde les chevets.
5
Le châlit : cadre du lit (longs pans et traverses) en bois ou en
métal, fermé par le chevet et le pied de lit, relié par les
battants.
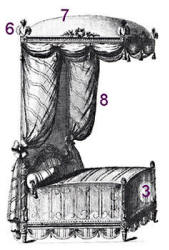
6
Aigrette : panaches des pavillons de lits qui forment les dais et
les baldaquins à l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe
siècle.
7
Baldaquin : élément de couverture ou de protection d'un trône, d'un
siège ou d'un lit. D'origine orientale, il est généralement formé
d'un châssis en bois reposant sur des colonnes et est revêtu d'une
pièce de tissu retombant en drapé.
Dais : étoffes drapées tendues au-dessus d'un lit ou d'un siège,
souvent ornées de panaches disposés aux quatre coins. C’est aussi
une sorte de petit toit de bois sculpté tendu au-dessus d'un siège
ou d'un lit.
Ciel de lit : cadre de tissu tendu au-dessus d'un lit, synonyme de
baldaquin.
8
Courtine : tenture servant à séparer une pièce ou une partie de
pièce de l’espace environnant, parfois même à isoler certains
meubles comme les lits à baldaquin.
|

